Matthew B. CRAWFORD, Éloge du carburateur : Essai sur le sens et la valeur du travail, traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Luc Fidel, Paris, La Découverte, coll. « Poche », 2024 (titre original : Shop Class as Soulcraft, 2009).
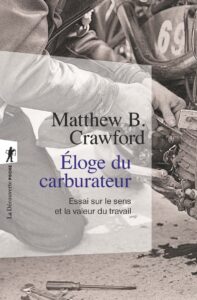
Dans un monde dominé par la virtualisation croissante du travail, la quête de sens dans les activités professionnelles devient un enjeu majeur. Avec Éloge du carburateur, Matthew B. Crawford, philosophe de formation et mécanicien de métier, propose un essai percutant qui plaide pour une revalorisation du « savoir-faire manuel et du rapport qu’il crée avec le monde matériel et les objets de l’art » (p. 8). Loin de toute nostalgie artisanale, l’ouvrage développe une réflexion profonde sur la nature du travail, la connaissance incarnée, la responsabilité, et la manière dont notre agir pratique peut redevenir un lieu d’excellence intellectuelle et morale.
L’auteur centre sa réflexion sur « l’expérience de ceux qui s’emploient à fabriquer ou réparer des objets » (p. 10), comme les mécaniciens, électriciens, menuisiers ou artisans. Il conteste l’idée selon laquelle la valeur d’un métier se mesure à son degré d’abstraction. Pour Crawford, les métiers manuels mobilisent une forme d’intelligence contextuelle, expérimentale, et réflexive, qui dépasse en complexité bien des tâches dites « intellectuelles ».
Crawford inscrit son propos dans une tradition phénoménologique qui valorise le rapport direct au réel : les objets résistent, obligent à réajuster les gestes, à interpréter, à apprendre de l’échec. Cette dynamique est aussi, écrit-il, une « éthique de l’entretien et de la réparation » (p. 13), qui implique attention, souci du détail et responsabilité. Il voit là « un mouvement qui répond à un besoin plus profond : le désir de rendre notre univers intelligible afin de pouvoir nous en sentir responsables » (p. 14).
Ce lien entre compréhension et engagement rappelle une intuition aristotélicienne fondamentale : « Le manque d’expérience diminue notre capacité d’adopter une vue d’ensemble […] ceux que leur engouement pour les discussions abstraites a rendus incapables d’observer les faits correctement sont excessivement enclins à dogmatiser » (Aristote, De la génération et de la corruption, 316a 5-9).
L’un des apports majeurs du livre est sa tentative de redéfinir l’agir humain : ni pure exécution, ni expression subjective, mais engagement réfléchi dans une activité finalisée. Crawford écrit en ce sens : « Le concept d’agir humain que j’ai essayé d’illustrer dans cet ouvrage est différent. Il s’agit bien d’une activité orientée vers une fin qui est affirmée comme bonne par l’agent, mais cette affirmation n’a rien d’arbitraire ou de strictement privé. » (p. 238)
Cela implique une prise de responsabilité éthique et cognitive, fondée sur l’expérience et l’attention à ce qui est réel, et non sur des procédures standardisées ou des prescriptions idéologiques.
L’ouvrage a été salué pour son originalité, son ton personnel et la richesse de ses analyses. Crawford réussit à tisser un lien entre la philosophie morale, la sociologie du travail, et l’expérience artisanale, donnant ainsi chair à un projet intellectuel cohérent et stimulant. Il rejoint en cela les travaux de Richard Sennett (Ce que sait la main) ou encore d’Ivan Illich (La Convivialité).
Le livre offre également une critique puissante du monde managérial et de la rationalisation du travail. Il dénonce un système qui valorise la conformité et la procédure au détriment du jugement personnel et de l’excellence pratique. Ce diagnostic rejoint celui d’auteurs comme Christophe Dejours ou Pierre-Yves Gomez, qui dénoncent également la déshumanisation du travail contemporain par les logiques de performance et de fragmentation.
Toutefois, certains critiques relèvent d’une idéalisation du métier manuel, qui pourrait faire abstraction des conditions concrètes d’exercice (précarité, fatigue, sous-valorisation sociale). Par ailleurs, Crawford ne développe que peu de pistes politiques concrètes pour réconcilier travail manuel et valorisation institutionnelle dans un système économique globalisé.
À l’heure où les métiers artisanaux connaissent une nouvelle reconnaissance et où les crises sanitaires et environnementales appellent à repenser nos modes de production, de consommation et de travail, l’ouvrage de Crawford offre un cadre intellectuel puissant pour redonner du sens à l’activité humaine. Il invite aussi à repenser la place de la transmission, de la lenteur, et du rapport au réel dans l’éducation.
Éloge du carburateur est un essai majeur sur la valeur existentielle et morale du travail concret, écrit dans une prose claire, incarnée, et nourrie d’une culture philosophique exigeante. Crawford n’offre pas un simple plaidoyer pour le travail manuel, mais une critique globale de notre rapport à l’activité, au monde et à nous-mêmes.
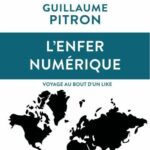

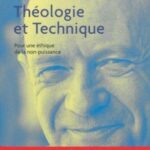
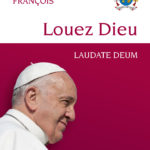


Laisser un commentaire