Marius DOROBANȚU, Theological Anthropology and the Possibility of Human-Level Artificial Intelligence: Rethinking Human Distinctiveness and the imago Dei, Université de Strasbourg, 2020.
La thèse de Marius Dorobanțu, soutenue à l’Université de Strasbourg en 2020 sous la direction de Marie-Jo Thiel, s’inscrit dans un champ de recherche émergent à l’intersection de l’anthropologie théologique et de l’intelligence artificielle (IA). Son objectif est d’examiner la possibilité d’une intelligence artificielle générale (AGI) atteignant un niveau cognitif comparable à celui des humains et d’interroger les implications d’un tel développement sur la notion chrétienne de l’imago Dei, c’est-à-dire l’image de Dieu en l’homme.
Ce travail se distingue par son approche interdisciplinaire combinant théologie, philosophie de l’esprit et sciences cognitives. L’auteur interroge la singularité humaine face à la montée des technologies intelligentes et cherche à déterminer si une IA avancée pourrait remettre en cause le statut ontologique et théologique de l’homme. Il propose en réponse un modèle relationnel de l’imago Dei, soulignant la relationalité comme critère distinctif de l’humanité.
Thèses principales et démarche de l’auteur
Dorobanțu commence par analyser les différentes interprétations théologiques de l’imago Dei, en particulier :
- L’interprétation substantielle, qui identifie l’image de Dieu avec des facultés humaines spécifiques (raison, conscience, libre arbitre).
- L’interprétation fonctionnelle, qui relie l’imago Dei à la capacité humaine de dominer la nature.
- L’interprétation relationnelle, qui met l’accent sur la relation entre Dieu, l’homme et autrui.
- L’interprétation eschatologique et christologique, qui considère l’image divine comme une finalité à atteindre dans l’union avec le Christ.
Ces modèles traditionnels sont-ils compatibles avec l’émergence d’une IA qui posséderait une intelligence comparable à celle des humains ?
L’auteur engage ensuite un dialogue entre théologie et sciences cognitives pour examiner la possibilité d’une AGI. Il passe en revue :
- Les théories computationnelles de l’esprit, qui assimilent l’intelligence humaine à un traitement algorithmique de l’information.
- Les critiques philosophiques de l’IA, notamment celles de John Searle (expérience de pensée de la chambre chinoise) et Hubert Dreyfus, qui montrent les limites des machines en termes de compréhension et d’intentionnalité.
- Les perspectives émergentes en neurosciences et IA, qui cherchent à modéliser des formes d’intelligence non strictement computationnelles.
Pour Dorobanțu, les systèmes d’IA actuels n’atteignent pas une véritable autonomie cognitive ni une subjectivité. La conscience artificielle reste une hypothèse spéculative. Face à l’incapacité actuelle de l’IA à développer une conscience relationnelle, Dorobanțu propose une réévaluation du concept de l’imago Dei. Il soutient que l’aspect distinctif de l’être humain ne réside pas uniquement dans la cognition ou la rationalité, mais dans sa capacité relationnelle. L’imago Dei est définie par la manière dont les humains interagissent avec Dieu et avec autrui.
Une IA pourrait éventuellement simuler des interactions sociales, mais elle ne posséderait pas la vulnérabilité et l’engagement authentique qui caractérisent l’humanité.
Cette approche rejoint les travaux de Jürgen Moltmann et Karl Barth, qui mettent l’accent sur la relation comme fondement de l’image divine.
Réception et critiques
L’un des grands mérites de cette thèse est son approche pluridisciplinaire, qui associe :
- Une analyse théologique approfondie des différentes conceptions de l’imago Dei.
- Une discussion philosophique des théories de l’esprit et de l’intelligence artificielle.
- Une prise en compte des avancées scientifiques en neurosciences et en IA.
Contrairement à Noreen Herzfeld (In Our Image: Artificial Intelligence and the Human Spirit), qui adopte une vision plus ouverte sur une possible hybridation homme-machine, Dorobanțu reste prudent et insiste sur la relationalité comme limite essentielle. En dialogue avec Jean Ladrière, qui voit dans la technique un prolongement de l’humanité, il questionne plutôt les ruptures que pourrait induire une AGI.
Si la réflexion sur l’AGI est stimulante, elle repose sur des scénarios hypothétiques, étant donné que l’IA actuelle est encore loin d’atteindre un niveau de conscience humaine. Certains critiques pourraient ainsi juger prématuré de tirer des conclusions théologiques sur un phénomène encore largement spéculatif.
Bien que la thèse explore les dimensions théologiques et philosophiques de l’AGI, elle accorde relativement peu de place aux conséquences éthiques et politiques de ces technologies. Par exemple, comment les avancées en IA redéfinissent-elles le travail, la responsabilité et la dignité humaine ? Ou encore, l’intégration d’IA avancées dans la société pourrait-elle modifier la perception de l’humanité et de la personne ?
Actualité et pertinence du texte
À l’ère de l’IA générative et des algorithmes décisionnels, la question de l’imago Dei dans un monde technologique est plus pertinente que jamais. Cette thèse s’inscrit ainsi dans un débat de fond sur l’identité humaine face aux mutations technologiques. Les discussions sur la personnalité juridique des IA ou sur le transhumanisme rejoignent certaines des interrogations soulevées par Dorobanțu.
Cette thèse constitue une référence pour les théologiens travaillant sur l’anthropologie chrétienne et la modernité technologique, les philosophes de l’esprit intéressés par les limites de l’intelligence artificielle, les éthiciens et théoriciens du numérique analysant l’impact de l’IA sur l’identité humaine.

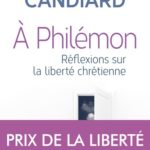
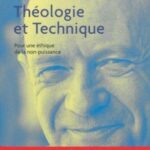
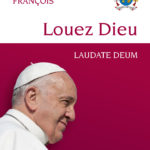

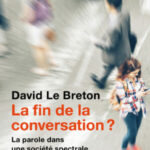
Laisser un commentaire